Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
Hors-Séries - Le numéro 173 du 13 août 2025
Consultez le sommaire détaillé des articles parus dans ce numéro de Hors-Séries.
Feuilletez un extrait de cette parution. Achetez le numéro au format papier ou numérique pour le retrouver sur votre espace client et l’application KiosqueMag.
KiosqueMag, la boutique officielle de Hors-Séries propose l’accès le plus complet aux archives de la revue.

Au sommaire de ce numéro
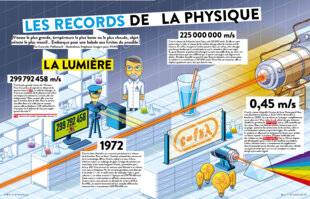
LES RECORDS DE LA PHYSIQUE
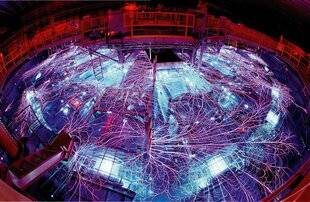
PHYSIOUE PHÉNOMENALE
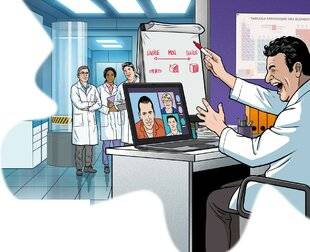
PLONGÉE AU CŒUR DE LA MATIÈRE MOLLE

LA QUÊTE DES SUPRA CONDUCTEURS
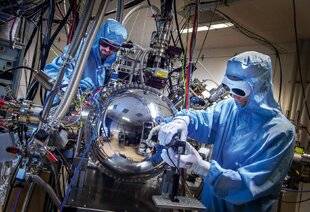
UN LABO QUI FILME L'INVISIBLE !



































