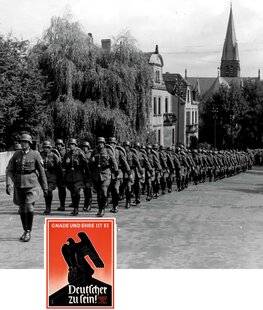Lorsque la guerre éclate en Italie au printemps 1701, la situation des Bourbons est optimale. Leurs troupes sont plus nombreuses. Le Milanais est solidement fortifié. Les autres puissances de la région sont alliées ou neutres, et leurs adversaires doivent déboucher d'Autriche par les Alpes pour les attaquer. Mais les princes italiens refusent une domination franco-espagnole sans partage sur la péninsule. Ils aident donc les Impériaux à y reprendre pied, sous le commandement d'un chef d'exception : Eugène de Savoie (voir l'encadré p. 28), auréolé de ses victoires contre les Turcs. Le prince ne dément pas sa réputation : après une série de manœuvres audacieuses, il bat les Franco-Espagnols à Carpi le 9 juillet. Excédé par ce mauvais départ, Louis XIV remplace le vieux Catinat par Villeroy, son ami d'enfance. Dès son arrivée, le fringuant maréchal se jette sur l'armée d'Eugène… et se fait étriller à Chiari le 1er septembre. Plus humiliant encore, le 1er février 1702, Eugène réalise un audacieux coup de main sur Crémone, où les Français sont retranchés. Grâce à la complicité d'un prêtre local, dont la maison communique avec l'extérieur par un aqueduc abandonné, il arrive à infiltrer des troupes dans la place. Tiré de son lit par les coups de fusil, Villeroy est capturé. La situation est rétablie grâce au sang-froid de quelques troupes, dont les régiments irlandais, qui y gagnent une durable réputation de férocité. DÈS SON ARRIVÉE, LE FRINGANT MARÉCHAL VILLEROY SE JETTE SUR EUGÈNE… ET SE FAIT ÉTRILLER. Mauvais départ Pour les Français, la déconvenue de Crémone est sévère, même s'ils se réjouissent d'être pour un temps débarrassés de Villeroy, remplacé par un général d'un tout autre calibre, le duc de Vendôme. Volontiers prétentieux, de mauvaise foi, procrastinateur, ce dernier sait également se montrer agressif, capable de renverser une situation compromise par un mouvement vif et opportun. Il est en outre apprécié des soldats. Le prince Eugène commence à reculer quand, coup de théâtre, le duc de Savoie Victor-Amédée II, jusqu'alors allié de Versailles, fait défection. Privés du contrôle des cols alpins, les Franco-Espagnols sont contraints de se battre sur deux fronts. Un pareil grignotage s'observe au même moment sur le théâtre où Français, Anglais, Espagnols et Hollandais viennent traditionnellement vider leurs querelles : les Pays-Bas méridionaux. Les opérations démarrent en août 1702, avec l'entrée en scène de l'autre géant militaire de la Grande Alliance, le duc de Marlborough (voir l'encadré ci-dessous). À peine arrivé, et malgré sa relative inexpérience militaire, celui-ci force les Français à reculer en manœuvrant sur leurs arrières et en les menaçant d'une bataille que les généraux de Louis XIV préfèrent éviter. En quelques semaines, presque sans coup férir, il s'empare des forteresses de la Meuse, dégage Maastricht et libère les Provinces-Unies de toute menace d'invasion. Début 1703, les Français conservent leur attitude défensive. Ils s'abritent derrière les lignes du Brabant, une série de fortifications appuyées sur les cours d'eau belges. Pour les franchir,
Le contenu complet de cet article est réservé aux abonnés. Vous pouvez également acheter Guerres & Histoire n°87 au format digital. Vous le retrouverez immédiatement dans votre bibliothèque numérique KiosqueMag.
Voir plus