Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
hors-séries - Le numéro 19 du 25 juin 2025
Consultez le sommaire détaillé des articles parus dans ce numéro de hors-séries.
Feuilletez un extrait de cette parution. Achetez le numéro au format papier ou numérique pour le retrouver sur votre espace client et l’application KiosqueMag.
KiosqueMag, la boutique officielle de hors-séries propose l’accès le plus complet aux archives de la revue.

Au sommaire de ce numéro

LE CORPS D'ARMÉE, CLÉ DE LA « RÉVOLUTION OPÉRATIVE » NAPOLÉONIENNE
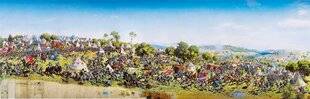
LES SUISSES MATENT LE TÉMÉRAIRE EN TROIS COUPS
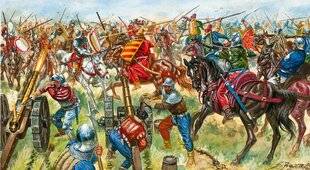
RAVENNE, 1512 : ET LA GUERRE MODERNE FUT !

HÉRACLÉE, LE PREMIER CHOC ENTRE LÉGION ET PHALANGE

CARRHES, LE DÉBUT DU CAUCHEMAR PARTHE



































