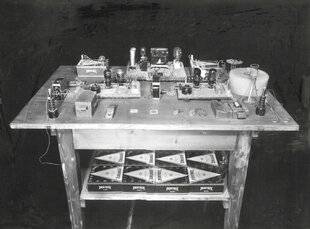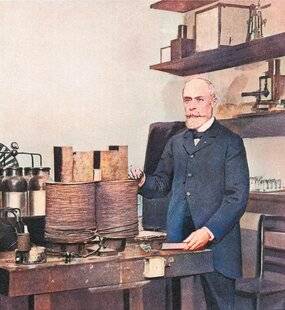En décembre 1938, la physicienne Lise Meitner, juive autrichienne en exil au Danemark, rend visite à son neveu, le jeune physicien Otto Frisch, à Kungälv, près de Göteborg, en Suède. Jusqu'à l'Anschluss, elle était la collaboratrice d'Otto Hahn avec lequel elle a conduit des travaux sur la radioactivité. Celui-ci vient de bombarder des atomes d'uranium avec des neutrons qui semblent alors se fragmenter en plusieurs éléments plus légers, sans doute du baryum. Il transmet les résultats à Meitner pour avoir son avis. L'air frais stimule les neurones. La veille de Noël, la physicienne et son neveu partent s'asseoir sur un banc dans la forêt enneigée voisine et calepin en main refont les calculs. Quelques griffonnages plus tard, tout s'éclaire : le noyau d'uranium s'est brisé en deux fragments. Meitner s'appuie sur « le modèle de la goutte » du savant danois Niels Bohr avec qui elle travaille désormais : le noyau d'un atome n'est pas une masse solide, mais doit être interprété comme une goutte de liquide capable de se diviser. Et lors de la division, l'énergie qui soude l'atome est libérée conformément à la formule d'Einstein E=MC2. Inspiré par la division cellulaire des biologistes, Otto Frisch baptise le phénomène « fission nucléaire ». Et c'est ainsi, bien loin des paillasses des laboratoires et des conseils de comités militaires, que commence la folle histoire de la bombe atomique. Avec la découverte de la fission, de nombreux scientifiques estiment qu'il est désormais possible de créer une réaction en chaîne, de l'énergie à volonté, mais aussi une explosion et donc une arme de destruction massive. « Frédéric Joliot-Curie dépose ainsi en mai 1939 un brevet secret portant sur la possibilité d'utiliser une réaction en chaîne nucléaire à desfins explosives » , rappelle Jean-Marc Le Page, historien, chercheur associé au laboratoire Tempora de l'université Rennes 2. « Des chercheurs comme En-rico Fermi, Leó Szilárd, Eugene Wigner ou Edward Teller, des Européens réfugiés aux États-Unis à la suite des persécutions nazies, comprennent rapidement les implications militaires de la fission. » Szilárd, un juif hongrois
Le contenu complet de cet article est réservé aux abonnés. Vous pouvez également acheter Les Cahiers de Science et Vie n°224 au format digital. Vous le retrouverez immédiatement dans votre bibliothèque numérique KiosqueMag.
Voir plus