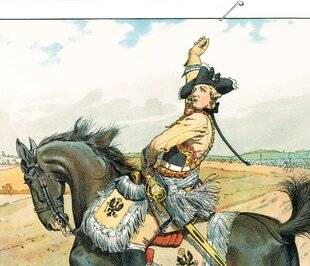Né le 9 avril 1926 à Saint-Raphaël dans une famille d'immigrés italiens communistes, LÉON LANDINI s'engage dans la Résistance à 16 ans et rejoint par la suite les FTP-MOI de Lyon, ce qui lui vaut après-guerre, entre autres, la croix d'officier de la Légion d'honneur et la médaille de la Résistance française. Régulièrement hospitalisé jusqu'en février 1946 à cause des tortures subies, grand invalide de guerre, il devient exploitant forestier dans le Var avant de rejoindre la région parisienne en 1963 pour travailler dans la restauration collective. Militant de toujours du PCF, il a fondé et préside depuis 2004 un mouvement alternatif, le Pôle de renaissance communiste en France (PRCF). Dernier survivant des FTP-MOI, il fait partie de la Garde d'honneur lors de l'entrée de Missak et Mélinée Manouchian au Panthéon, le 21 février 2024. Après-guerre, il a eu trois filles dont Gilda, historienne de la Résistance. Item sans titre Guerres & Histoire : Commençons par le commencement. Pouvez-vous nous parler de votre jeunesse ? Léon Landini : Je viens d'une famille de paysans et de charbonniers de Toscane. Miséreux, mais politisés. En 1915, mon père Aristide refuse de partir à l'armée et il est condamné à vingt ans de bagne. Amnistié une fois la paix revenue, il fonde la première cellule communiste locale en 1921. Et puis les Chemises noires débarquent et tuent onze personnes. Mon père parvient à s'échapper et à passer clandestinement la frontière française. Il travaille dans les mines de fer de l'Est, puis fait venir sa femme, Violette, et ses deux enfants au Muy, dans le Var, où se trouve déjà une colonie d'Italiens antifascistes. C'est là que je viens au monde, en 1926. Je grandis en écoutant les conversations politiques de nos aînés - je peux dire que j'ai « tété du lait rouge » ! Toutes ces valeurs sont restées les miennes : fraternité, égalité, dignité, et une insatiable soif de justice sociale dans un monde en paix. Dans les années 1930, la maison Landini devient le refuge de tous les étrangers clandestins de passage, des Allemands, des Espagnols, des Italiens… Palmiro Togliatti, le secrétaire national du PC italien, séjourne chez nous. Personne ne sait son vrai nom : il se fait appeler Ercole Ercoli. Les enfants sont élevés pour cacher des clandestins et ne rien dire. En 1939, c'est le début de la guerre. Que font les Landini ? Mon père, trop âgé, ne peut rejoindre l'armée française. Mon frère Roger y conduit des camions. À l'été 1940, ils sont renvoyés à la maison [communiste repéré, Roger fait 48 jours de prison pour avoir violé son assignation à résidence, ndlr] . On quitte Le Muy, où les gendarmes nous cherchent des poux, pour Saint-Raphaël. La gare de triage de Fréjus est à proximité. Un matin, début décembre 1940, mon frère et un copain y vont avec une grosse barre à mine pour casser les roues des wagons. Ils voyaient les trains pleins partir en Allemagne, alors qu'eux n'avaient plus rien à manger. Les voilà donc spontanément résistants ? Mon frère décide de continuer, mais beaucoup de ses amis communistes sont mariés et craignent pour leur famille. Il réunit donc une petite bande de jeunesses communistes, dont il était membre. Moi, à 15 ans, je veux aussi être résistant. Avec mon copain Jeannot Carrara, on va coller des étiquettes sur les murs de Saint-Raphaël, sur la porte des flics -« Pétain,tu as trahi la France »,
Le contenu complet de cet article est réservé aux abonnés. Vous pouvez également acheter Guerres & Histoire n°86 au format digital. Vous le retrouverez immédiatement dans votre bibliothèque numérique KiosqueMag.
Voir plus